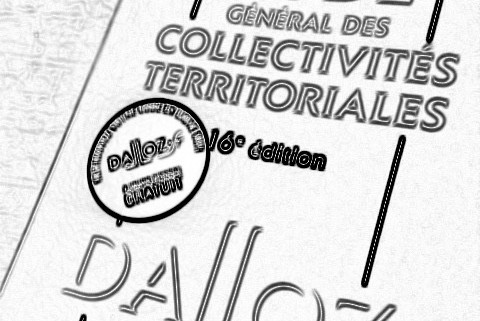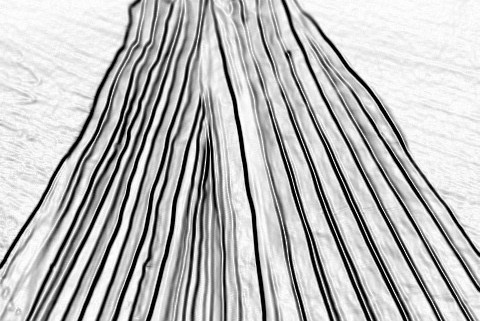Expulsion : quels délais pour les squatters ?
Pour appréhender les délais d’expulsion de squatters ou d’occupants sans droit ni titre, plusieurs hypothèses doivent être envisagées.
Les délais de droit commun (trêve hivernale et délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux)
Confronté à une occupation illégale, le propriétaire qui souhaite reprendre possession de son bien doit engager une procédure en référé.
S’agissant des expulsions de logements illégalement occupés l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Les procédures civiles d’exécution ont fait l’objet d’une codification à droit constant, de différents textes dont la loi n°91-960 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
Cette codification a été opérée par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.
La partie réglementaire est issue pour sa part du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution.
En pratique il s’est simplement agi de codifier les différents textes d’ores et déjà en vigueur sans modifier l’ordonnancement juridique.
Le juge d’instance, puis le juge de l’exécution, disposent d’un large pouvoir pour accorder des délais.
Pour le propriétaire, qui a intérêt à voir diminuer ou supprimer ces délais, il est capital de les anticiper dès le début de la procédure.
L’article L412-1 du Code des procédures d’exécution prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui peut être réduit ou supprimé par le juge :
‘Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.’
Les articles L.412-2 et suivants précisent les modalités d’expulsions et la faculté pour le juge et le juge de l’exécution d’accorder des délais aux occupants des immeubles à usage d’habitation ou professionnel.
L’article L412-2 permet au juge de proroger ce délai en cas de conséquence d’une exceptionnelle dureté pour les occupants:
‘Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.’
L’article L412-3 permet également au juge d’accorder des délais renouvelables si les occupants justifient de l’impossibilité pour eux de trouver un nouveau logement :
‘Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.’
L’article L412-4 précise que ces délais, ne peuvent excéder trois ans :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
L’article L412-5 précise toutefois que les délais sont suspendus si le Préfet n’a pas été informé au stade du commandement :
‘Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en informe le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.’
L’article L412-6 précise enfin que durant la période hivernale il doit être sursis à toute mesure d’expulsion sauf à ce qu’une voie de fait ait été démontré ou que l’immeuble soit l’objet d’un arrêté de péril imminent ou non imminent :
‘Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que dès le début de la procédure et en particulier au stade du constat de l’occupation, le propriétaire victime d’une occupation illégale de son bien doit se constituer un certain nombre de preuves afin d’échapper à ces différents délais qui peuvent varier de 0 à plus de trois ans !
Le propriétaire devra s’attacher à démontrer une éventuelle flagrance mais surtout l’existence d’une voie de fait.
La flagrance
En cas d’infraction flagrante, les squatters peuvent être expulsés immédiatement.
En matière de squat d’immeubles bâtis, les forces de l’ordre considèrent, en principe, qu’avant l’expiration d’un délai de 48 heures, il est possible d’expulser les contrevenants dans la mesure où il s’agit d’un cas de flagrant délit de violation de domicile (serrure fracturée, carreaux cassés, volets arrachés…).
Passé le délai de 48 heures, il est nécessaire de saisir le juge compétent afin d’obtenir une décision de justice.
En droit, l’article 53 du Code de procédure pénale définit la flagrance et la procédure du même nom comme suit :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
Le délai de 48 heures appliqué par les forces de l’ordre, et connu des squatters, relève en réalité plus d’une pratique et ne repose pas, à ma connaissance, directement sur une disposition législative ou réglementaire.
A ce stade de mes recherches, j’irai jusqu’à parler de légende urbaine enseignée dans les écoles de police.
Dans le cadre d’une proposition de loi n° 2480 du 13 juillet 2005, il avait d’ailleurs été proposé de porter à 72 heures le délai dans lequel la police peut intervenir pour constater le flagrant délit d’occupation illicite.
Selon les parlementaires auteurs de cette proposition, ce délai, « fixé par les textes à 48 heures », serait habituellement ramené à 28 heures par la jurisprudence.
Cette proposition est demeurée sans effet, ce qui est bien dommage pour les propriétaires d’immeubles squattés.
Il n’existe, à ma connaissance, aucun texte fixant le délai de flagrance à 48h.
En pratique, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux qui vient d’être commis ou va l’être de façon imminente.
Le constat de flagrance permet de mettre en oeuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale.
L’article 54 du Code de procédure dispose ainsi que :
« En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. »
L’article 62-2 du même Code va jusqu’à légitimer la mise en garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit en état de flagrance :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La flagrance est donc un constat de ce qu’un délit ou un crime vient d’être ou est en train d’être commis et permet la mise en oeuvre de mesures conservatoires, avant même qu’une juridiction ait été saisie et se soit prononcée.
L’existence d’une voie de fait
Si les occupants pénètrent dans les lieux au moyen de dégradations, ils ne pourront en principe prétendre au bénéfice d’aucun délai.
Les squatters, occupants sans droit ni titre par excellence, ne peuvent en principe pas prétendre au bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article 613-3 du Code de la construction et de l’habitation désormais codifié dans le Code des procédures civiles d’exécution à l’article L.412-6 :
» Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’ Le juge des référés peut également supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (…), réduire ou supprimer ce délai. »
Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour d’Appel de Rennes a estimé que le simple fait d’occuper un immeuble d’habitation sans l’accord du propriétaire constitue une voie de fait :
« Considérant que non seulement l’occupation de l’immeuble sans l’accord du propriétaire mais également le refus opposé à son libre accès constituent une atteinte au droit de propriété ; qu’en tant que telle, ils caractérisent des voies de fait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. » (CA Rennes, 29 janvier 2013, RG n°11/00872)
Tous les espoirs restent donc permis…
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Police du bruit : « La Cour de récréation » un cas d’école
« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » disait Saint François de Sales
Par un arrêt du 17 janvier 2013 la Cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser l’étendue des pouvoirs de police du maire en matière de nuisances sonores liées à l’existence d’un équipement public.
En l’espèce, des riverains se plaignaient du bruit généré par les enfants dans la nouvelle cour de récréation située à proximité de leur habitation.
L’Expert venu mesurer les émergences sonores avait d’ailleurs révélé que la combinaison des voies stridentes des bambins évoluant dans la cour de récré dépassaient largement les seuils réglementaires.
Pour autant, la Cour a considéré que les pouvoirs de police du Maire s’arrêtaient aux portes de l’école.
Plus précisément, les juges d’appel ont souligné que les bruits sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution et ne sont pas au nombre de ceux que le Maire est tenu de réprimer.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise acoustique à laquelle les requérants ont fait procéder en octobre 2010, que les bruits issus de la cour de récréation jouxtant nouvellement leur propriété, dépassent significativement le seuil d’émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; que, toutefois, les requérants ne contestent pas sérieusement que cette nouvelle cour n’accueille chaque jour que deux récréations d’une vingtaine de minutes et seulement en période scolaire ; que par ailleurs, l’expertise acoustique n’ayant été réalisée que pendant une de ces récréations, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les activités périscolaires et extrascolaires également invoquées généreraient à leur égard des nuisances supplémentaires ; qu’ainsi les bruits issus de la nouvelle cour de récréation de l’école maternelle, qui sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution, n’apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées ; » (CAA LYON, 17 janvier 2013, N° 12LY00984)
Dans la droite ligne de cette décision, la Cour administrative d’appel de NANCY avait déjà eu l’occasion de considérer que la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être recherchée dans la mesure où les nuisances proviennent non pas de l’ouvrage public mais de l’utilisation qui en est faite.
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente Jacques Duclos à THIL, les bruits de musique, dont l’importance excessive du fait des volumes sonores justifiés aux heures nocturnes tardives est établie mais dont l’existence devait être connue des requérants au moment de l’acquisition de leur immeuble, n’ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l’ouvrage lui même mais l’utilisation qui en est faite ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; » (CAA NANCY, 10 janvier 2005, N° 01NC01206).
Dans cet arrêt la Cour avait également pris soin d’écarter la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
« Considérant, en second lieu, que les troubles générés par l’utilisation de la salle polyvalente sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos de M. Eric X et Mme Dolorès Y dont l’immeuble est mitoyen de la salle ; que, cependant, d’une part, informées de cette situation par leur plainte, les autorités communales ont fait procéder à d’importants travaux d’insonorisation de la salle ; que, d’autre part, la commune établit qu’au cours des années 1997, 1998 et 1999, ont eu lieu respectivement 17 manifestations dont 2 en nocturne avec musique, 29 manifestations dont 4 en nocturne avec musique et 23 manifestations dont 3 en nocturne avec musique, y incluses le bal du 14 juillet et la soirée du nouvel an ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que des désordres ont eu lieu sur la voie publique justifiant l’intervention de la police ; qu’ainsi, eu égard à la très faible utilisation nocturne de cette salle pour des manifestations sur fond de musique, au règlement strict qui régit l’utilisation de la salle communale tant dans l’espace que dans le temps, le maire doit être regardé comme n’ayant pas fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute ; »
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Droit des collectivités : responsabilité du maire à raison des nuisances causées par les occupants d’une aire d’accueil
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des nuisances subies par les riverains d’une aire d’accueil.
La prétendue carence des services de l’Etat n’est pas, à elle seule et à la supposée établie, de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité.
Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour d’appel de BORDEAUX est venue rappeler ce principe qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence :
« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2°Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage, (…)et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les pollutions de toute nature… » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 28 septembre 2009 à la demande de MmeA…, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, rédigés tant en juillet 2009 qu’au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013, et de planches photographiques dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée provisoirement sur l’unité foncière située en face de l’habitation de M. B…et de MmeA…, que ladite aire est utilisée, par certains de ses occupants, comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique ; que l’environnement de ce terrain est détérioré par de nombreux détritus et déjections, y compris des déjections humaines, qui affectent la salubrité des lieux ; qu’en outre, Mme A…a été conduite à porter plainte, le 2 mai 2012, en raison de blessures causées à un de ses animaux domestiques par un tir de fusil qu’elle impute à des occupants de ladite aire pour les avoir vus en possession d’une telle arme peu avant et peu après le coup de feu ; que si, pour contester les éléments de preuve ainsi produits par M. B…et MmeA…, la commune de Graulhet se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux le 24 juin 2009, ce document se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages ; qu’il en est de même du rapport convenu des services de cette direction du 11 décembre 2009, à la suite d’une visite programmée et effectuée le 3 décembre 2009 avec un élu et des responsables de l’administration de la collectivité ; que, dans ces conditions, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire de Graulhet a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Graulhet ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, que les services de l’Etat ont pu commettre une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage que subissent M. B…et MmeA… ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’usage non conforme de l’aire d’accueil des gens du voyage, l’état d’insalubrité de l’environnement de cet équipement et les risques pour la sécurité de leurs animaux ont causé à M. B…et MmeA…, indépendamment des atteintes qui ont pu être portées à leur tranquillité par les occupants de l’aire, des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont ils sont en droit d’obtenir réparation ; que, si M. B…et Mme A…ont contesté devant la juridiction administrative plusieurs des actes relatifs à la création de l’aire d’accueil définitive sur le territoire de la commune de Graulhet, au demeurant sur un terrain à proximité immédiate de l’aire actuelle, cette circonstance ne permet pas de leur imputer les préjudices subis, contrairement à ce que soutient la collectivité ; que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation excessive de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre en la fixant à la somme de 15 000 euros ; » (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, N°13BX01069).
En cas de non respect des règles applicables à l’aire d’accueil et notamment du réglement intérieur la commune a tout intérêt à saisir le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé mesure utile aux fins d’expulsion.
La procédure est relativement rapide puisqu’il convient de prévoir une quinzaine de jours pour obtenir une ordonnance.
Voir notamment :
« Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d’urgence ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. et M. G. se sont installés avec leurs véhicules et caravanes sans droit ni titre sur l’aire d’accueil Les Mollaires sise à Saint-Florent-des-Bois laquelle est gérée par La-Roche-sur-Yon agglomération ; que des arrêtés leur ordonnant de quitter les lieux sans délai ont été pris par le président de cet établissement public le 10 avril 2015 ; que la demande de la collectivité ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l’évacuation des intéressés revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que des dégradations des équipements ont été constatés le 31 mars 2015 outre un départ de feux dans le local poubelles et l’incendie d’un véhicule volé sur un terrain vague situé à proximité de l’aire d’accueil ;
4. Considérant par suite, qu’il y a lieu, d’enjoindre aux intéressés et à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai les lieux et de dire, qu’à défaut de ce faire, la communauté d’agglomération X pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de M. M.et de M. G. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération X en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; » (TA Ordonnance de référé du 29 avril 2015, n°1503269)
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Droit de propriété : peut ont faire supprimer une servitude de vue ou un simple jour ?
L’article 676 du Code civil relatif aux jours précise que :
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
L’ouverture de jours respectant les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil correspond à l’exercice normal du droit de propriété et n’implique aucune prétention de servitude sur le fonds voisin.
L’ouverture d’une fenêtre qui est un simple jour et non pas une vue droite ne peut pas entraîner l’acquisition par prescription d’une servitude de vue.
Le propriétaire du « fonds servant » ne peut, en principe, pas en demander la suppression.
Rien ne lui empêche, en revanche, de bâtir un mur, même à l’extrême limite de votre fonds, en respectant la réglementation et ainsi obstruer les jours ouverts sur son fonds.
S’il s’agit en réalité d’une vue au sens de la jurisprudence, la question est un peu plus délicate.
S’agissant des servitudes de vue, l’article 688 du Code civil dispose en effet que :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. »
L’article 689 dispose pour sa part que :
« Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. »
L’article 690 précise enfin que :
« Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
S’il n’existe aucune mention dans les titres et que la vue existe depuis moins de 30 ans, la suppression de la vue peut être exigée.
En effet la jurisprudence considère de manière constante, y compris lorsqu’il existe un acte sous-seing privé, (c’est-à-dire une convention prévoyant la création d’une servitude au profit d’une personne et non d’un fonds) qu’une servitude doit être reprise par acte authentique :
« Constitue une condition intrinsèque de validité de la servitude de vue la reprise par acte authentique, pour inscription au livre foncier, de l’acte sous seing privé autorisant la création de vues droites.
La mention de l’acceptation des servitudes existantes dans l’acte de vente d’un immeuble ne saurait régulariser la servitude de vue litigieuse, celle-ci doit donc être supprimée. » (Cour d’appel, COLMAR, Chambre civile 3, 5 Novembre 1990, Numéro JurisData : 1990- 050314)
En l’absence de mention de la servitude dans le titre, l’action du propriétaire du « fonds dominant » ou des éventuels acquéreurs destinée à obtenir le maintien du jour serait difficile à mettre en œuvre.
« L’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. Il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre de servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. » (CAA Lyon, 15 octobre 2013, N°12/02660).
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit de la construction : L’intérêt du référé préventif en droit administratif
A l’occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l’un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.
Un constat d’huissier est envisageable ainsi qu’une expertise amiable réalisée par un homme de l’art.
Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.
En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l’homme de l’art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.
En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.
Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.
Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
L’article R. 532-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »
La mission de l’expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne….)
L’objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.
Ainsi, si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.
Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.
Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l’expert puisse s’adjoindre les conseils d’un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d’effondrement, milieu sensible….).
Dans le cadre d’une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d’expertise aux entreprises en charge des travaux.
Du point de vue de la procédure, et à l’inverse de la procédure judiciaire, c’est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.
Le coût pour la collectivité s’avère donc moins important que dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d’expertise.
Le montant des frais d’expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d’expertise, voire même après le dépôt du rapport.
En règle générale, il convient de prévoir un délai d’environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d’un expert judiciaire.
Jérôme MAUDET
Avocat au Barreau de NANTES
Chute sur la voie publique et responsabilité de la collectivité
La victime d’une chute sur la voie publique est en droit, en sa qualité d’usager, de demander réparation à la collectivité à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi.
La victime devra toutefois démontrer que sa chute est due à un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Le juge administratif exige que l’imperfection de la voie excède les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les piétons.
Ainsi, une saillie de 2 centimètres a été jugée insuffisante :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la chute de Mme B… a été provoquée par une des dalles en pierre de la chaussée qui était partiellement descellée et qui faisait ainsi saillie sur la voie publique ; que si la chute a eu lieu de nuit, il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage de la rue, composé notamment de deux lanternes situées de part et d’autre du lieu de l’accident, aurait été insuffisant ; que les photographies produites par la requérante concordent avec l’attestation établie par la responsable du service voirie de la commune faisant état de ce qu’une dalle descellée, comme celle ayant causé la chute, crée un dénivelé de 2 cm au maximum ; qu’une telle imperfection du sol restait d’une ampleur limitée et était suffisamment visible par un piéton normalement attentif ; qu’ainsi, cette saillie n’a pas constitué, en l’espèce, un danger tel qu’elle puisse être regardée comme un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, quand bien même la présence de cette légère défectuosité ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière à l’attention des usagers de la voie ; » (CAA de LYON, 6ème chambre – formation à 3, 24/04/2014, 13LY01941).
Voir également en ce sens pour une saillie de 2,5 cm :
« Sur la responsabilité :
3. Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant que M. C…soutient que, le 25 février 2007 aux environs de 11 heures alors qu’il circulait à pied rue Lisette à Allauch, il a buté et glissé » sur une plaque métallique rendue glissante par le froid et la pluie « , il n’a pu » se rattraper du fait de l’affaissement du pavage » et qu’il » s’est sérieusement blessé du fait de la disjonction des pavés » ; qu’à supposer que la chute dont a été victime M. C…en pleine journée ait été provoquée par les déformations de la chaussé pavée, il résulte de l’instruction que les différences de niveau de la chaussé relevées par constat d’huissier, au demeurant plus de quatre ans après les faits, qui atteignent 5,5, 6 et 7 centimètres en certains endroits de la chaussée, trouvent leurs causes soit dans l’existence d’une pente naturelle et régulière, soit dans la présence d’une rigole destinée à faciliter l’évacuation des eaux pluviales ; que, par ailleurs, les attestations de riverains qui mentionnent que cette rue » serait à refaire car elle est vraiment dangereuse « , qu’elle est » très pentue et pavée de manière très inégale » et que » quand il pleut, l’eau accentue les détériorations et la dangerosité de cette voie » ne sont pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’entretien normal de la voie publique ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que ces obstacles, y compris la présence d’une bouche à clé formant sur la voie une saillie de 2,5 centimètres, n’excédaient pas par leur nature ou leur importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer ; que, par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole établit l’entretien normal de l’ouvrage public ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 31/10/2013, 11MA02752)
Ou encore :
« 3. Considérant que MmeA…, alors âgée de 70 ans et résidant au 4 de la rue de la Dime à Maillane, soutient être tombée le 7 avril 2004 à hauteur du n°6 de cette rue après avoir heurté une » bouche à clé » qui faisait saillie sur la voie publique et que la SEERC doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident en invoquant, à titre principal, sa qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause et, à titre secondaire, sa qualité d’usagère de ce même ouvrage public pour défaut d’entretien normal ;
4. Considérant, qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant que Mme A…établit avoir chuté le 7 avril 2004 au niveau du n°6 de la rue de la Dime en heurtant une » bouche à clé « , incorporée à la voie publique et à l’égard de laquelle elle avait la qualité d’usager, par la production de l’attestation rédigée le 18 avril 2004 par le témoin des faits et du certificat médical établi le 21 avril 2004 par le centre hospitalier d’Avignon où elle a été admise le jour de son accident en vue du traitement de sa fracture ouverte de l’humérus droit ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des trois procès-verbaux de constat dressés par huissier les 14 avril 2004, 22 septembre 2004 et 14 septembre 2011 à la demande de Mme A…que la » bouche à clé » en litige dépassait du sol de la voie publique de deux centimètres environ ; qu’ainsi, cette défectuosité n’excédait pas celles que doit s’attendre à trouver sur sa route un usager normalement attentif de la voie publique et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent et attentif ; qu’en outre, la chute s’est produite à proximité immédiate du domicile de l’intéressée qui ne pouvait ignorer l’état des lieux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, l’accident s’étant produit au mois d’avril et en journée même si Mme A…n’indique pas l’heure précise à laquelle il est survenu dès lors qu’elle fait valoir qu’elle venait de quitter son domicile pour effectuer ses courses au super marché du village ; qu’en outre, malgré l’absence de trottoir, la largeur de la voie publique lui permettait de contourner sans difficulté cet obstacle ; que dans ces conditions, Mme A…n’est pas fondée à soutenir qu’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage incorporé à la voie publique et à l’égard duquel elle avait la qualité d’usagère, serait à l’origine de sa chute ; » (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2ème chambre – formation à 3, 19/09/2013, 11MA03123)
Même en présence d’une saillie suffisante (5 cm) la faute de la victime est susceptible d’exonérer totalement ou partiellement la collectivité de sa responsabilité :
« Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la tranchée incriminée a été creusée dans une rue de la commune de Merlimont pour l’extension du réseau de gaz ; que les travaux ont été réalisés par la SLTP pour le compte de la société GRDF, maître d’ouvrage ; que la société ARTOIS COORDINATION SECURITE assurait la mission de coordonnateur-sécurité ; que cette tranchée, partiellement remblayée dans l’attente de la pose d’enrobé, présentait une profondeur évaluée, selon le procès-verbal de gendarmerie, à 5 centimètres et longeait la chaussée sur une longueur d’environ 30 mètres, avant de la traverser ; qu’il est constant que cet obstacle ne faisait l’objet d’aucune signalisation ; qu’ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur la profondeur de l’excavation, et alors même qu’aucun autre accident n’a été signalé à cet endroit, celle-ci excédait les obstacles que les usagers doivent s’attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique ; que, dans ces conditions, la commune de Merlimont n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique ;
Considérant, toutefois, que l’accident de M. A s’est produit le 27 mars 2005 sur l’avenue Adolphe Leroy vers 9 heures 50, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes et que l’obstacle, ainsi que l’indique lui-même M. A, était parfaitement visible ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de l’intéressé, qu’il a roulé dans la tranchée et qu’il a » continué dans cette saillie pour [se] retrouver sur la gauche de la chaussée face à [son] sens de marche » ; qu’il ressort de la configuration des lieux, qui étaient connus de la victime, qu’il était possible de circuler sur la chaussée le long de la tranchée, et ce, alors même que celle-ci traversait l’avenue ; que, dès lors, M. A n’a pas su adapter sa conduite en vélo au danger représenté par la tranchée en cause et a, ainsi, manqué à l’obligation de prudence à laquelle il était tenu en sa qualité d’usager de la voie publique ; que cette faute de M. A est de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de Merlimont, seule responsable de l’entretien de la voirie communale ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser M. et Mme A ; » (Cour administrative d’appel de Douai, 2e chambre – formation à 3, 27/03/2012, 11DA01040)
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit de propriété : qui peut juger l’implantation irrégulière d’un ouvrage public ?
L’atteinte au droit de propriété relève en principe du juge judiciaire.
La question de la responsabilité d’une personne publique ou d’une entreprise chargée d’une mission de service public relève, quant à elle, de la compétence du juge administratif.
En présence d’une voie de fait, le juge judiciaire retrouve toutefois sa compétence.
Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que, dès lors que les requérants se prévalent d’une emprise irrégulière qui ne peut pas se rattacher à un pouvoir de l’administration, seul le juge judiciaire a vocation à connaître d’une telle demande.
Voir en ce sens, pour un exemple nantais :
« Considérant que la requérante ne soutient pas, et qu’il ne ressort pas du dossier, que l’empiètement allégué aurait été autorisé par une décision ou un acte administratif dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître ; Que dans ces conditions, dans la mesure où le fait invoqué comme origine du préjudice est susceptible de constituer une emprise irrégulière sur une propriété privée, le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. » (TA NANTES, 24 mai 2012 n°0905137)
Par un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation est toutefois venue préciser que la circonstance que l’ouvrage soit mal implanté n’est pas, à elle seule, constitutive d’une voie de fait :
« Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont assigné la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), sur le fondement de la voie de fait, aux fins de la voir condamnée à procéder à l’enlèvement du poteau électrique implanté sur une parcelle de terrain leur appartenant ; que la société ERDF a soulevé l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour rejeter cette exception d’incompétence, l’arrêt, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que le poteau électrique litigieux fût un ouvrage public, énonce que si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il en va autrement d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et lorsqu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ; » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 Février 2015 – n° 14-13.359, 193).
Jérôme MAUDET
Avocat au Barreau de NANTES
Droit pénal de l’urbanisme : délais de transmission des procès-verbaux
Les infractions au Code de l’urbanisme doivent être constatées par un agent assermenté dûment habilité à cet effet.
En principe, le Procès-Verbal d’infraction doit être transmis au Parquet avant l’expiration d’un délai de 3 jours.
L’article 29 du Code de procédure pénale dispose en effet que :
« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. »
Le non-respect de ces délais de 3 jours est toutefois apprécié avec bienveillance par le juge judiciaire en application de l’adage « pas de nullité sans grief » :
« Attendu que, pour rejeter l’exception tirée de la nullité du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007, l’arrêt retient notamment que la nullité prévue par l’article 29 du code de procédure pénale, qui n’est pas une nullité d’ordre public, ni une nullité résultant de la violation des droits de la défense, ne fait pas grief aux prévenus dès lors qu’ils ne sont pas directement lésés, ni même concernés par cette irrégularité relative au délai de transmission de la procédure au procureur de la République, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par les appelants que l’inobservation de ce délai ait porté atteinte à leurs intérêts ; » (Cass. Crim. 7 décembre 2010. N° de pourvoi: 10-81729)
Il n’en demeure pas moins préférable de respecter le délai de 3 jours pour éviter tout débat inutile sur ce point.
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit des collectivités : subventions et conseillers municipaux intéressés
Il est souvent délicat de distinguer l’intérêt de la commune dans son ensemble et l’intérêt personnel de un ou plusieurs élus.
Cette difficulté, est renforcée par le fait que la jurisprudence administrative n’a jamais dégagé de définition précise de la notion d’intérêt personnel à l’affaire.
L’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Le Conseil d’Etat considère de manière générale que l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 décembre 1994, req. n°145370).
Cependant, la simple présence du conseiller municipal ne suffit pas à remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal.
Le juge administratif vérifie si la participation de l’élu a été de nature à lui permettre d’exercer une influence sur le résultat du vote.
L’existence d’une influence de l’élu sur le résultat du vote fait l’objet d’une appréciation par le juge administratif au regard du cas d’espèce.
L’influence effective sur le résultat du vote est appréciée souplement par la jurisprudence.
Voir en ce sens pour une illustration récente :
« Sur le moyen tiré de la participation au vote d’un conseiller municipal intéressé :
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ;
- Considérant qu’à supposer même que l’un des conseillers municipaux ayant participé à l’adoption de la délibération attaquée aurait été personnellement intéressé au classement de parcelles lui appartenant, cette circonstance est restée sans influence sur le classement des parcelles appartenant aux requérants ; que, par suite, le moyen fondé sur les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; » (CAA DOUAI, 5 mars 2015, N°13DA02153)
Il faut donc que l’influence de l’élu intéressé ait été effective, c’est-à-dire que sa participation ait été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote.
S’agissant de l’intérêt personnel des élus à l’affaire, l’article L.2123-11 précité prohibe la participation au vote d’un élu qui pourrait être directement intéressé par la délibération.
Il est préférable que le conseiller municipal membre actif d’une association ne peut puisse participer à une délibération la concernant. Cette affirmation doit toutefois être nuancée :
« Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que cependant, dès lors que l’association dont s’agit présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d’administration n’est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions précitées ; » (CAA MARSEILLE, 16 septembre 2003, n°99MA01085).
Par ailleurs, le lien de parenté de l’élu ou du conseiller avec des personnes intéressées n’est pas, à lui seul, de nature à établir l’existence d’un intérêt personnel :
« 5. Considérant, (…) que si M. Ducros de Lafarge de Romefort fait état de ce que la belle-soeur et les neveux et nièces de Mme C…conseillère municipale, sont propriétaires en indivision du bien dont l’acquisition fait l’objet des délibérations litigieuses et que l’époux de cette dernière serait notoirement attaché à la réalisation du projet d’ouverture d’un bar, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme C…aurait influencé le vote du conseil municipal ; qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l’affaire dont il est délibéré par le conseil municipal, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; » (CAA LYON, 11 Juillet 2013, N° 12LY01336).
Toutefois, l’existence d’un lien de famille entre l’un des architectes désignés pour l’élaboration du POS et le maire a ainsi pu être interprétée comme étant constitutive d’un intérêt personnel de ce dernier (CE, 10 juin 1992, n° 94644).
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Trouble du voisinage : perte de vue et d’ensoleillement
La construction d’une extension crée généralement des désagréments aux voisins déjà installés sur place.
Ces désagréments s’ils sont constitutifs d’un trouble ne sont pas, pour autant, constitutifs d’un trouble anormal du voisinage.
La Cour d’appel de MONTPELLIER a d’ailleurs estimé que l’obstruction d’une vue, à la supposer même « imprenable », ne constitue pas, à elle seule, un trouble anormal de voisinage :
« la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n’est pas un droit susceptible en lui-même de protection tant qu’il n’y a pas de troubles dépassant l’inconvénient normal de voisinage.
Ainsi, en achetant un chalet implanté sur le lot No33 du « Lotissement du Lac», Les consorts Y… ne pouvaient ignorer que la « vue exceptionnelle sur le lac de MATEMALE et sur les Pyrénées » dont ils jouissaient n’était nullement garantie, et constituait un avantage précaire qui cesserait tôt ou tard lorsqu’une construction serait édifiée sur la parcelle voisine encore non bâtie du même lotissement, le fait que leur maison ait été édifiée en premier ne leur conférant aucune prééminence, aucun droit de s’opposer à des constructions ultérieures sur les fonds voisins.
En d’autres termes, la perte d’agrément – voire même de 25 % de la valeur de leur bien ainsi qu’ils le prétendent – pouvant résulter de la réduction de la vue causée par l’implantation du nouvel immeuble, ne peut être considérée en soi comme un trouble anormal ou excessif, dans la mesure où elle ne procède que de l’exercice du droit légitime du propriétaire voisin de construire dans le respect des règles en vigueur, sauf aux époux Y… à rapporter la preuve de circonstances particulières démontrant un abus de ce droit, générateur de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Or force est de constater qu’ils se bornent à faire valoir que leur vue s’arrête désormais à la façade de ce bâtiment qui masque le panorama, mais n’apportent aucun élément concret permettant de démontrer que ce trouble présente un caractère anormal ni que l’immeuble n’a pas été édifié conformément au permis de construire et aux prescriptions d’urbanisme. Au contraire, les photographies produites révèlent que la construction qui les prive en partie de la vue sur le lac n’est pas un bâtiment particulièrement inesthétique, ou encore d’une hauteur de nature à générer un sentiment d’enfermement, mais un chalet en bois d’un étage de belle facture apparente, dans le style du pays.
Ne rapportant pas dès lors la preuve de l’existence des troubles anormaux de voisinage qu’ils invoquent, les consorts Y… seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes. » (CA MONTPELLIER, 3 juin 2008, N°07/4081).
S’agissant de la perte d’ensoleillement, la jurisprudence a coutume de rappeler que les avantages dont bénéficie un propriétaire, tels qu’une vue dégagée ou un ensoleillement important, ne sont pas des droits acquis, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1993), que M. X… ayant édifié une construction en limite de sa propriété, contiguë à celle de M. Y…, ce dernier se plaignant d’une diminution de l’ensoleillement et de l’éclairement, l’a assigné en dommages-intérêts en invoquant un trouble anormal de voisinage ; (…)
Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… n’est pas fondé à se plaindre d’une diminution de l’ensoleillement et de l’éclairement de sa maison par suite de l’extension de la construction de M. X… en limite de sa propriété et de la perte d’un avantage nécessairement précaire au centre d’une agglomération très peuplée, cet inconvénient ne constituant pas en de telles circonstances un trouble anormal de voisinage ; » (Cass. Civ. 2, 3 mai 1995, pourvoi: N°93-15920)
La Cour d’appel de CAEN a d’ailleurs rappelé qu’en dépit d’une perte d’ensoleillement avérée, la construction d’un hôtel n’est pas de nature à justifier une action pour trouble anormal du voisinage.
« Ne constitue pas un trouble anormal de voisinage l’édification, sur un terrain jouxtant l’immeuble des revendiquants, d’un hôtel.
En effet, les propriétaires d’appartements n’ont d’une part aucun droit acquis opposable à la société d’investissement de bénéficier d’une vue sur la mer telle qu’elle empêche la construction d’un immeuble de 3 ou 4 étages. (…)
Enfin, sur l’ensoleillement, dans une zone relativement urbanisée, une perte d’ensoleillement en fin de soirée est dans l’ordre des choses, étant observé que la clarté peut continuer sans ensoleillement direct. » (Cour d’appel de Caen, 17 Mars 2009, N°07/03576).
Par un arrêt du même jour la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé cette position :
« la perte d’ensoleillement, limitée, qui procède de l’exercice du droit légitime du propriétaire voisin d’édifier une maison, ne constitue pas, alors que les constructions sont situées dans un milieu urbain et constructible où nul ne dispose d’un droit acquis sur l’environnement et où chacun peut s’attendre à être privé d’un avantage en fonction de l’évolution du contexte, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et ouvrant droit à réparation. » (Cour d’appel de MONTPELLIER, 17 mars 2009, N° 07/03576).
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES