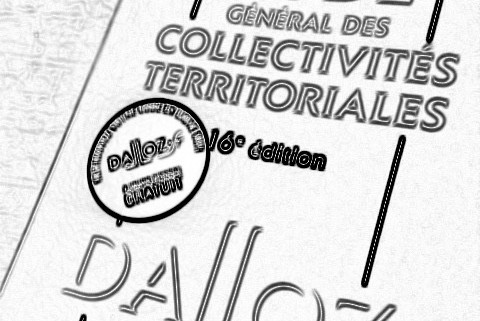Collectivités : recours direct de la victime contre les entreprises en charge de travaux publics
Le recours dont dispose les tiers contre le maître d’ouvrage s’étend aux personnes privées qui ont réalisé les travaux publics, sans condition de délai sous réserve de la prescription quadriennale.
En d’autres termes, la victime peut agir soit contre l’entrepreneur, soit contre le maître de l’ouvrage, soit contre les deux solidairement sur les mêmes fondement à savoir la responsabilité sans faute ou pour faute présumée.
Les principes relatifs à la responsabilité des entrepreneurs à l’égard des victimes des dommages de travaux publics s’appliquent en cas de sous-traité.
La victime peut donc agir non seulement contre l’entrepreneur sous-traitant, qui a exécuté effectivement les travaux, mais également contre l’entrepreneur titulaire du marché.
Cette action n’est possible que si le fait dommageable est imputable à l’entrepreneur :
« Considérant qu’il résulte des rapports de l’expert désigné par les premiers juges, dont les conclusions reposent sur une étude de la nature et de la structure des sols ainsi que du régime des pluies, que les désordres apparus sur le chantier de M. Garnero ont eu pour cause, non comme le soutiennent les sociétés requérantes, des pluies exceptionnelles, mais les travaux entrepris, à une vingtaine de mètres en surplomb, pour la construction de l’autoroute A 8 ; que les tirs de mines, les injections de ciment après forages qui ont été effectués, ainsi que la pression même des piliers construits, ont profondément modifié le réseau des fissures du terrain, accru le phénomène de résurgence des eaux et provoqué des éboulements de terrain ; qu’ainsi il est établi que les désordres dont la société civile immobilière Majoma et M. Garnero ont demandé réparation ont pour cause les travaux de construction de l’autoroute ; que, dès lors, les sociétés Spad et Citra-France ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Nice a retenu leur responsabilité dans la survenance des désordres ; » (Conseil d’Etat, Sous-section 5, 5 Février 1990 – n° 46170)
Il n’est toutefois pas nécessaire que le fait dommageable ait pour cause une faute de l’entrepreneur.
L’entrepreneur ne peut pas, vis-à-vis de la victime, s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de faute de sa part, notamment la circonstance que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art.
Il peut seulement invoquer, à cette fin, soit la faute de la victime soit la force majeure
« 3. Considérant, d’une part, que, même en l’absence de faute, la collectivité maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; » (CAA Douai, 15 oct. 2013, n° 12DA00831, Cne Pont-de-l’Arche : JurisData n° 2013-025720).
Charge éventuellement à l’entreprise mise en cause de solliciter la garantie du maître d’ouvrage si elle s’y estime fondée.
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit public : Retrait d’un acte créateur de droit au profit de plusieurs bénéficiaires
Le retrait d’une décision créatrice de droit ne peut intervenir qu’après observation d’une procédure contradictoire permettant à son bénéficiaire de présenter des observations sur la mesure de retrait envisagée.
L’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations désormais codifié à l’article 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit en effet que :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. »
Par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a considéré, à propos d’un permis de construire qu’il s’agit d’une garantie fondamentale dont le nom respect emporte la nullité de la décision de retrait :
« le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter » et juge en conséquence « qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ».
Cette obligation est toutefois écartée dans le cas où il est statué sur une demande, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, lorsque le respect de cette procédure serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ou enfin lorsque des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. L’autorité administrative n’est en outre pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Encore faut-il que l’ensemble des bénéficiaires soient informés de la décision ou aient formé une demande de retrait.
Voir en ce sens :
« Considérant que la délibération du 20 mars 2009 » approuve les conditions des ventes du lot E1 au profit des acquéreurs cités ci-dessus [ M. B… et Mme E… -C… agissant pour le compte de la SCA MetB ] ou de toute personne physique ou morale qu’il leur plaira de substituer » ; que cette délibération ne pouvait être analysée comme créatrice de droits qu’au seul profit de la SCA MetB alors en cours de constitution ; qu’en outre, elle ne comportait aucune condition suspensive relative au délai dans lequel la société devait être constituée ; que le courrier présenté le 18 mai 2009 par M. B… à titre individuel demandant l’annulation du protocole d’accord et du permis de construire ne pouvait être regardé comme émanant du bénéficiaire de cette délibération, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… -C… aurait renoncé à son bénéfice, ni que la constitution de la société SCA MetB aurait été rendue impossible ; que, dans ces conditions, et en l’absence d’une demande présentée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles avait été souscrite la demande initiale, la commune ne pouvait légalement procéder au retrait de la délibération du 20 mars 2009 par la délibération en litige ; » (CAA NANTES, 29 novembre 2013, N°11NT02809)
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit pénal de l’urbanisme : que faire en cas de non respect d’un arrêté interruptif de travaux ?
Le fait de poursuivre des travaux malgré la notification d’un arrêté interruptif constitue une infraction au Code de l’urbanisme prévue et réprimée par l’article L.480-3 dudit Code lequel prévoit que :
« En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement.
Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »
Sans attendre la décision de la juridiction éventuellement saisie le Maire a la possibilité, si ce n’est le devoir, de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme à la poursuite des travaux.
L’article L.480-2 dispose en effet que :
« Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agents visés à l’article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. »
La pose de scellés peut être effectuée par le Maire ou l’un de ses adjoints ou par tout agent dûment habilité et commissionné à cet effet.
Afin de se constituer la preuve de la pose de scellés, il me semble qu’il est judicieux pour le Maire ou l’agent de se faire accompagner par un huissier lequel dispose d’ailleurs du matériel nécessaire.
Son constat devra ensuite être transmis au Procureur pour information.
Il appartiendra ensuite au destinataire de l’arrêté, s’il s’y estime fondé, de solliciter judiciairement la main levée de l’arrêté interruptif et la dépose des scellés.
L’article L.480-2 précité prévoit en effet que :
« L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. »
S’il venait à procéder à la dépose des scellés sans décision de justice préalable, la commune n’aurait alors qu’à en référer au Procureur lequel ne manquera pas, à mon sens, d’engager l’action publique et de faire montre d’une grande sévérité à son égard.
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Droit pénal de l’urbanisme : qui est responsable en cas d’irrégularité d’un arrêté interruptif de Travaux ?
Seule la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être recherchée à raison de l’irrégularité d’un arrêté interruptif de travaux.
En effet, l’arrêté interruptif de travaux est un acte administratif s’inscrivant dans le cadre d’une procédure judiciaire durant laquelle le maire agit au nom de l’État :
« 3. Considérant que si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme ; » (CE, 26 juin 2013, n° 344331)
Jérôme MAUDET
Avocat
Urbanisme : extension, démolition, reconstruction et taxe d’aménagement
Un pétitionnaire qui souhaite procéder à une extension de son habitation est il redevable de la taxe d’aménagement pour la portion de la construction qu’il a déconstruite puis reconstruite ?
L’article L.331-6 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. »
La circulaire du 18 juin 2013 relative à la fiscalité de l’aménagement prévoit en son article 1.3.1.8 ce qui suit :
« 1.3.1.8. – Exonération pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli ou pour la reconstruction de locaux sinistrés
Il s’agit de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions.
Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, reconstruit à l’identique, est exonéré si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1) Le bâtiment reconstruit a la même destination, le même aspect extérieur, la même surface de plancher, les mêmes dimensions et la même implantation (sauf cas de dangerosité avérée) ;
2) La construction précédente avait été régulièrement autorisée ;
3) Il n’y a pas eu de remise de taxe concernant les locaux détruits ou voués à la démolition en cas de catastrophe naturelle (article L. 331-10 4°).
Les conditions d’exonération indiquées à l’article L. 331-7 8° pour les reconstructions après sinistre sur un autre terrain que le terrain initial sont cumulatives. En cas d’affectation partielle du nouvel immeuble à une destination différente de l’immeuble ancien, l’exonération n’est applicable qu’à la partie recevant l’ancienne affectation. De même, si la surface de la construction est supérieure à celle du bâtiment sinistré, l’excédent doit être soumis à la taxe dans les conditions de droit commun.
Peuvent être qualifiés de sinistres, les destructions de constructions résultant d’un des évènements suivants : un incendie, une inondation, une tempête, une catastrophe naturelle, une catastrophe technologique ou un attentat, ainsi que la démolition de bâtiments suite à des malfaçons du constructeur, après expertise judiciaire. »
Il résulte de ce qui précède, sous réserve d’une reconstruction à l’identique ou d’un sinistre, que les services de l’Etat sont fondés à solliciter le paiement de la taxe pour la partie démolie puis reconstruite.
Jérôme MAUDET
Avocat au Barreau de Nantes.
Droit public : restriction des délais de recours contentieux
En principe, à réception d’un recours, l’administration doit accuser réception du recours et mentionner les délais et voies de recours au requérant. En règle générale le requérante dispose d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif d’un recours.
A défaut d’être expréssement mentionné dans l’accusé réception, le délai de recours ne court pas.
Le Conseil d’Etat est toutefois venu préciser que le délai de recours ne saurait courir ad vitam eternam.
« 4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu’il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable ;
5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ;
6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B…a reçu notification le 26 septembre 1991 de l’arrêté portant concession de sa pension de retraite du 24 juin 1991, comme l’atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension, et que cette notification comportait mention du délai de recours de deux mois et indication que l’intéressé pouvait former, dans ce délai, un recours contentieux ; que si une telle notification était incomplète au regard des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont M. B…a saisi le tribunal administratif de Lille plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée comme tardive ; qu’il en résulte que les conclusions présentées par M. B…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; » (CE 13 juillet 2016, n°387763)
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit des collectivités : l’interdiction des libéralités est d’ordre public
L’interdiction des libéralités pour les collectivités n’est pas nouvelle.
Le principe a été posé par la jurisprudence Mergui il y a 45 ans. (CE, Sect., 19 mars 1971, Mergui, n° 79962)
En substance, la juridiction administrative considère que la liberté contractuelle des collectivités s’arrête à la notion de libéralité.
Ce qui peut se résumer comme suit : Une collectivité ne peut pas s’engager ou être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Par un arrêt du 7 mars 2016, le Conseil d’État est venu rappeler cette règle d’ordre public en ces termes :
« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 28 janvier 2004, le directeur général de l’établissement public Centre national de la cinématographie, devenu Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a rejeté la demande du groupe Combret, dont font partie la Société d’Expansion du Spectacle (SES) et les sociétés Euro Vidéo International (EVI) et Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), tendant à l’indemnisation du préjudice allégué résultant de l’attribution irrégulière à un tiers de sommes lui revenant pour ses salles de cinématographie situées dans le sud de la France ; que, par un jugement du 30 janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du CNC du 28 janvier 2004 mais rejeté les demandes des sociétés SES, EVI et COMECI tendant à la condamnation du CNC au versement d’une indemnité de 7 094 630,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 2003 ; que, par un arrêt du 31 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par les mêmes sociétés, a sursis à statuer sur leur requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question de la propriété des salles de cinématographie dites » du sud » ; que, par l’arrêt attaqué par le CNC, la cour a condamné l’établissement public à raison du préjudice résultant de la faute commise par le CNC en accordant, par la décision du 11 août 1995, le regroupement au profit d’un tiers des comptes de soutien financier de plusieurs salles cinématographiques, d’une part, à verser à la société SES une somme de 359 017,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003 et, d’autre part, à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 317 636,67 euros pour la période 1995-1998 ;
2. Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables ; que cette interdiction est d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique : » Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique (…) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie » ; qu’aux termes de l’article premier du décret du 27 mars 1968 : » Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, donner délégation au directeur général du centre national de la cinématographie, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l’industrie cinématographique(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, abrogées par l’article 2 du décret du 15 mars 1996 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et donc en vigueur à la date de la décision du 11 août 1995 autorisant le regroupement litigieux de soutiens financiers, que cette décision a été prise pour le compte de l’Etat et non pour celui du CNC ;
4. Considérant qu’en jugeant que par la décision du 11 août 1995 autorisant, ainsi qu’il a été dit, le regroupement au profit d’un tiers des soutiens financiers du CNC accordés aux salles de spectacle du groupe Combret, le CNC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors que cette décision avait été prise pour le compte de l’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés SES, EVI et COMECI ; » (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 07/03/2016, 375632, Inédit au recueil Lebon)
Jérôme MAUDET
Avocat
Collectivités : régime juridique des biens appartenant au domaine public
Les règles applicables en matière de domanialité publique se résument par deux mots : l’indisponibilité, et l’imprescriptibilité.
Ces deux notions sont reprises à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que :
« Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
La notion d’indisponibilité s’oppose à la libre disposition, par son propriétaire, d’un bien lui appartenant.
La destination à laquelle ce bien est affecté justifie son indisponibilité.
Tel est le cas pour le domaine public dont l’affectation à l’usage du public ou à un service public justifiera son indisponibilité. Autrement dit, dès lors qu’un bien aura fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exercice d’un service public et aura été affectés directement à l’usage du public, il sera indisponible.
La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé, à propos d’un jardin servant à des manifestations municipales, que :
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée B 261 qui jouxte l’Abbaye, utilisée au moment de son achat en 1925 comme jardin de l’école de filles de la commune, puis occupée par des agents d’EDF après le transfert de l’école en 1957, sert actuellement, et ce depuis plusieurs années, à des manifestations municipales et est ainsi affectée à l’usage direct du public ; que la seule attestation de l’ancien maire, qui se borne à soutenir que la partie de la parcelle B 261 restant à la disposition de la commune a toujours été exploitée comme jardin par les locataires des logements loués par cette dernière, ne remet pas sérieusement en cause l’affectation de ce terrain à l’usage du public ; que la circonstance qu’une portion de cette parcelle ne serait plus accessible au public à raison de la clôture posée irrégulièrement par M. D… en 1963 n’a pu avoir pour effet, en l’absence de déclassement, de faire sortir ce terrain, lequel forme un tout indivisible, du domaine public de la commune de Cormery ; que, par suite, la domanialité publique pleine et entière de la parcelle cadastrée B 261 doit être regardée comme établie »
L’une des principales conséquences de cette impossibilité de disposer librement du bien affecté à l’usage du public ou à un service public est l’inaliénabilité de ce bien.
Les personnes privées ne peuvent donc pas devenir propriétaires des dépendances du domaine public dès lors que ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un acte de déclassement.
Cet acte de déclassement a pour effet de faire sortir le bien du domaine public et permet alors d’en disposer librement. A défaut, le bien ne peut pas être cédé.
La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé en ce sens que :
« Considérant que s’il ressort des deux délibérations susmentionnées que le bien immobilier dont s’agit a été désaffecté, aucune décision expresse n’a constaté son déclassement ; que, par suite, ledit bien, qui appartenait au domaine public de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, ne pouvait être cédé à la société SOCOGIM ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le nouveau maire de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy a refusé de signer l’acte authentique de vente dudit bien immobilier n’est pas fautive et n’est pas ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy » (C.A.A. Nancy, 19 mai 2011, n°10NC01492).
L’impossibilité d’aliéner une dépendance du domaine public n’empêche cependant pas son utilisation par une personne privée.
Cette dernière peut donc exercer une activité mais cette occupation obéit à des règles strictes fixées aux articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques lequel dispose que :
« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Outre ce caractère personnel et conformément à l’article L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, cette autorisation ne présente qu’un caractère précaire et révocable.
En ce sens, la juridiction administrative affirme, de jurisprudence constante que :
« Les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu’il est ainsi toujours loisible à l’autorité chargée de la police du domaine de les retirer pour un motif d’intérêt général, sans que leur bénéficiaire ait un droit acquis à leur maintien ou à leur renouvellement, en vertu des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques » (C.A.A. Marseille 11 janvier 2016, n°14MA01989).
Cela signifie donc que la personne publique peut, pour un motif tiré de l’intérêt général, mettre fin à cette autorisation ou ne pas la renouveler.
La Cour administrative d’appel de Marseille a appliqué cette règle à l’exploitant d’un restaurant sur le domaine public maritime :
« Considérant qu’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisation n’ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; qu’en effet, les autorisations d’occuper le domaine public sont accordées à titre précaire et révocables en vertu des règles de la domanialité publique et ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires qui n’ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement » (C.A.A. Marseille, 3 octobre 2011, n°10MA00029).
Jérôme MAUDET
Avocat au Barreau de NANTES
Collectivités : conditions de l’appartenance d’un bien au domaine public
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
Il ressort de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un bien appartienne au domaine public de la commune :
– ce bien doit lui appartenir
et
- – soit affecté à l’usage direct du public ;
- – soit affecté à un service public et que des aménagements aient été effectués pour exécuter cette mission de service public.
La juridiction administrative confirme l’exigence de cette double condition, prêtant une attention particulière à la seconde :
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les parcelles en litige sont affectées à l’usage direct du public et ont été spécialement aménagées à cet effet par la COMMUNE D’ANTIBES ; que, par suite, elles constituent des dépendances du domaine public communal » (C.A.A. Marseille, 20 décembre 2011, n°10MA01504).
A l’inverse, si une de ces deux conditions vient à manquer, le juge administratif est plus sévère.
La Cour administrative d’appel de Versailles juge en ce sens que :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que la parcelle sur laquelle est situé le carneau litigieux appartenant à la commune de Meudon n’est pas affectée à l’usage du public, l’accès au public y étant interdit, et n’a pas fait l’objet d’aménagements indispensables en vue de son affectation à un service public et n’a pas même reçu une telle affectation ; que la société BUHR FERRIER GOSSE n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de la commune de Meudon » (C.A.A. Versailles, 31 décembre 2015, n°14VE03297).
Le Conseil d’Etat veille également scrupuleusement au respect de cette double condition.
Tel est par exemple le cas pour un terrain laissé vide par la commune après la démolition d’un bâtiment lui appartenant. Ce terrain ne peut pas être considéré comme un bien appartenant au domaine public dans la mesure où, si la commune en est bien propriétaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement ait été affecté à l’usage direct du public ou à un service public :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public ; qu’elle n’a pas davantage été affectée à un service public ni fait l’objet d’un quelconque aménagement à cette fin ; qu’elle n’entrait pas, dès lors, dans les prévisions de l’article L. 2111-1 du même code » (C.E., 2 novembre 2015, n°373896).
Il ressort de cet arrêt que l’affectation au domaine public communal doit résulter d’une volonté intentionnelle de la commune. A défaut, le bien ou la dépendance visé(e) ne peuvent pas être considérés comme appartenant au domaine public.
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES